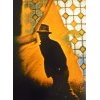La généalogie : une histoire de noms de familles
L’origine du patronyme qui se transmet héréditairement permet de suivre une lignée et les archives de retrouver les traces, pour certains de leur porteurs, jusqu’au Moyen-Age. L'apparition du nom remonte au X° siècle, avant, le nombre de villages est limité et chacun se connaît, l’usage d’un prénom suffit ; un surnom est parfois adopté par différents porteurs du même prénom afin de les distinguer.
 Les individus vivent et travaillent en groupes. Chaque individu occupe dans le groupe social plusieurs situations, il peut être un membre de la famille, exercer un métier particulier, voire occuper un statut particulier. La plupart des noms ont une signification précise. Au Moyen-Age, pour différencier les individus qui n’ont qu’un nom de baptême, on les affuble souvent du nom de leur terre d’origine, ainsi apparaissent : Dumas (du mas, ferme en provençal), Castel (château), ou d’une autre région, Lavergne, Lauvergne (Auvergne), Lenormand (de Normandie). Le nom peut parfois désigner une personne vivant près : d’un pont (Dupont), d’un fleuve, d’un marécage, etc. Dans les villes où l’on retrouve le plus souvent des artisans et négociants, le nom est parfois en relation avec la profession : Leboucher, Couturier, Barbier, Mitterand (le mesureur). Pour les artisans et commerçants, on fait précéder le métier de « Maistre » (dans de nombreux mots, la disparition de la lettre S a laissé place au tréma). D’autres patronymes révèlent une caractéristique sociale : Avoyer (avocat), Chevalier, Clerc, Évêque, Maréchal. Il est cependant à noter que les porteurs de ces noms n’exercent pas tous la dite profession ou charge, et qu'il peut être transmis par le maître à ses serviteurs.
Les individus vivent et travaillent en groupes. Chaque individu occupe dans le groupe social plusieurs situations, il peut être un membre de la famille, exercer un métier particulier, voire occuper un statut particulier. La plupart des noms ont une signification précise. Au Moyen-Age, pour différencier les individus qui n’ont qu’un nom de baptême, on les affuble souvent du nom de leur terre d’origine, ainsi apparaissent : Dumas (du mas, ferme en provençal), Castel (château), ou d’une autre région, Lavergne, Lauvergne (Auvergne), Lenormand (de Normandie). Le nom peut parfois désigner une personne vivant près : d’un pont (Dupont), d’un fleuve, d’un marécage, etc. Dans les villes où l’on retrouve le plus souvent des artisans et négociants, le nom est parfois en relation avec la profession : Leboucher, Couturier, Barbier, Mitterand (le mesureur). Pour les artisans et commerçants, on fait précéder le métier de « Maistre » (dans de nombreux mots, la disparition de la lettre S a laissé place au tréma). D’autres patronymes révèlent une caractéristique sociale : Avoyer (avocat), Chevalier, Clerc, Évêque, Maréchal. Il est cependant à noter que les porteurs de ces noms n’exercent pas tous la dite profession ou charge, et qu'il peut être transmis par le maître à ses serviteurs.
A partir du XII° siècle, le surnom tend à devenir héréditaire parmi les familles nobles puis de s’étendre à l’ensemble de la population. On distingue les surnoms « physiques » des surnoms « moraux ». Le premier repose sur une caractéristique physique (Lepetit), le second désigne des personnes qui se différencient par leurs qualités ou leurs défauts : Doucet, Hardy, Lesage, Vaillant, etc. Des noms animaliers sont également utilisés en corrélation avec un trait de caractère : Cocteau (coq querelleur), Renard (rusé), Chevrier (la chèvre pour son agilité). Le sobriquet à la différence du surnom, a une connotation humoristique ou désigne une particularité : Bachelard (jeune homme à marier), Gagnebien, Lesot (porteur d’eau dans un seau), Lesoldat, etc. Certains noms vont subir des modifications orthographiques liées au changement de région (Le bras/ Legrand en breton) ou sous l’erreur de rédacteurs retranscrivant le nom selon une interprétation phonétique, mais le sens ne change guère. Certains noms empruntés à celui d’une propriété, après s’être transmis génération après génération, ne correspondent plus à la réalité ; on retrouve des porteurs de ces noms de lieux loin de leurs terres d’origines. Si nombre de familles ont conservé ce nom accolé à leur patronyme, elles n’en sont plus pour autant propriétaire du dit domaine.
A partir du XV° siècle, des peuples d'origines différentes commencent à vivre au même endroit. L'homme ne dispose que de deux manières d'affronter les difficultés rencontrées (nourriture, guerre, zone inhospitalière, etc.), soit en s'y adaptant, ou en la quittant. L'importance des populations dépend des ressources offertes par la zone d'implantation et de sa sécurité. Le processus de fixation du patronyme s’affermit. Il faut attendre 1539 pour qu’apparaisse l’obligation de porter un nom de famille, qui est généralement celui du père. Les noms que l’on rencontre en France sont étroitement liés aux origines de la population formée par les diverses invasions, les vagues migratoires et les unions.
La vie de la famille est jalonnée par des changements : naissance, baptême, communion, mariage, naissances, divorce, décès, transmission du patrimoine. L’âge moyen du premier mariage est d’environ 24 ans, et les remariages à motif économique sont légion. Suite aux nombreux décès (épidémies de peste, typhoïde), ce pourcentage peut atteindre 50 % dans certaines régions ! Les mariages se font entre personnes de même condition sociale et souvent entre gens de la même zone géographique. La société est statique, seuls les notables et les commerçants vont chercher leur conjointe dans les grandes villes. On change très rarement de catégorie, le paysan devient rarement artisan.
L’ordonnance de 1539 de Villers-Cotterêt promulguée par François Ier va rendre la tenue des registres de l’état-civil obligatoire. Chaque curé rédige les « actes » à sa façon, et chaque changement de prêtre entraîne un changement dans la tenue des registres. Pour le clergé, la priorité est donnée au baptême. C’est la date de baptême qui « officialise » l’existence légale de l’individu, s’il décède entre les deux (la mortalité enfantine est très élevée, près de 25 % des enfants n’atteignent pas leur première année), il est inscrit dans les décès sans figurer dans les naissances !
Le registre des mariages se limite jusqu’au milieu du XVII° siècle, à l’énumération des couples mariés dans l’année et il figure sur les dernières pages du registre des baptêmes. Le prénom s’en trouve déterminé par celui d’un parrain ou d’une marraine. Vers 1660 apparaît la date du mariage et les noms des témoins. L’âge, la filiation, la profession des époux et celle des témoins apparaissent seulement vers la fin de ce siècle. Dans la grande majorité des cas, les mariés n’ont aucun bien propre : maison, terres, mobilier, bétail appartiennent aux parents. La mariée apporte une dot et son trousseau, le futur la robe de mariée et la bague. Dans certaines régions, les mariages sont prononcés à certaines périodes de l’année peu propices aux travaux agricoles.
Le mode d’enregistrement des décès connaît à son tour une évolution. D’abord simple liste très incomplète jusque vers 1650, le mortuaire s’améliore peu à peu avec les mentions de dates et de parenté. Certains prêtres indiquent la cause d’une mort accidentelle (chute de cheval, noyade, etc.). L’ordonnance de Blois de 1667 fera obligation au clergé d’indiquer le lien de parenté des époux, l’âge, la qualité, et le domicile sur les actes de mariage et de sépultures. Vers 1672, l’enterrement est certifié par deux témoins, généralement des proches, et l’inhumation a lieu dans le cimetière de la paroisse. Certains notables ont leur tombe dans l’église même et les seigneurs dans la chapelle de leur château.
L'État réalise que l’obligation d’inscription peut être utilisée pour l’imposition (Depuis 1539, le notaire a obligation de déclarer les actes signés en son étude, dans le but de percevoir par l'État les droits d’enregistrement). A partir de 1675, les registres doivent être rédigés sur du papier timbré et relié pour former des carnets. La copie peut en être faite des années plus tard par un copiste qui déchiffre difficilement l’original, ce qui va entraîner des variations orthographiques plus ou moins importantes. L’état-civil laïc intervient en 1792 en remplacement des registres paroissiaux et les règles de tenue des registres sont pratiquement « normalisées ». Les municipalités ont désormais la charge de rédiger les actes de naissance, mariage, décès. Avant 1789, un enfant né de parents Français à l’étranger était considéré comme un étranger, par contre, si des étrangers donnaient naissance à un enfant en France, celui-ci devenait Français.
Vers la fin du XVIII° siècle, on assiste à des changements de noms par déclaration publique. Le décret du 19 juin 1790 dispose qu’aucun citoyen ne pourra prendre que le vrai nom de sa famille. Certains vont renoncer à leur nom de domaine, titre et particule. La loi du 6 fructidor de l’an II (23 août 1794) interdit de porter autre nom et prénoms que ceux inscrits sur son acte de naissance. La loi du 11 germinal an XI va autoriser une modification du nom. Les motifs invoqués sont : la difficulté à porter certains patronymes obscènes (Cocu, Putin), qui évoquent la religion (Jésus, Rabbin, Curé), animaliers (Cochon, Vache, Lechien), alimentaires (Boudin, Lapoire, Navet), discriminatoires (Nabot, Chauve, Legras, Bossus), connotation sexuelle (Puceau, Labitte). Certains de ces patronymes dépréciés n’avaient absolument pas le même sens au XV° siècle que celui qui lui est attribué de nos jours. Labitte par exemple, était un casseur de pierre, et Lacrotte désignait l’habitant d’une dépression. La modification reste souvent minime, il peut s’agir du remplacement d’une lettre, Putin devient Dutin, l’ajout d’une lettre finale ou d’un accent, amputation, Ducon devient Duc, Chaudron donne Haudron, anagramme, Lecul - Lucel. S’il s’agit d’un patronyme d’origine étrangère, le porteur peut avoir recours à la simplification Tcherniakowoski - Tchernia, ou à la francisation : Israël - Iser.
Le décret de 1872 permet d’introduire une demande de changement de nom devant le conseil d'État pour modifier un patronyme importable, déshonoré, le franciser, l’associer d’un nom d’ancêtre ou un nom de guerre (exemple Chaband-Delmas), ou relever un nom qui risque de tomber en déshérence . Cela peut déboucher sur la notion de nom d’usage, avec cependant l’impossibilité de cumuler plus de trois noms puisque le nom d’usage n’est pas transmissible. Exemple, Melle Dupont née de Mme Durant pourra se faire appeler Dupont-Durant. Voila qui risque de compliquer les recherches concernant des patronymes antérieurs au XIX° siècle.
Lors de la naissance d’un enfant naturel, la mère quittait bien souvent la région pour se réfugier dans l’anonymat d’une ville où elle était inconnue. En cas de mariage d’une fille mère plusieurs années après la naissance de l’enfant illégitime, l’époux peut reconnaître l’enfant pour régulariser une situation défavorable, mais qui n’atteste pas de la filiation véritable de l’enfant. En 1870, l’apparition du livret de famille fige l’orthographe de tous les noms de familles, et à partir de 1897 apparaît la notion de la mention (divorce, remariage, adoption, filiation ) en marge de l’acte. Le 28 octobre 1922, l’acte de naissance porte la date et le lieu de naissance des parents, mais il faut attendre 1945 pour que le décès y figure.
Certains roturiers doivent leur titre à Napoléon III (noblesse d’Empire) qui transformera un simple Durand en Durand de Grossouvre. La particule n’est absolument pas une preuve de noblesse. Des personnes ont pu être anoblies et intégrées à cette classe en acquérant titres et privilèges, la disparité règne. On distingue l’ancienne noblesse, période antérieure à 1789, et la nouvelle noblesse pour la période postérieure. S’y ajoutent la noblesse d’épée (bataille), de finance (achat), par lettre (conférée par le roi), de robe (acquise par la fonction), militaire (conférée pour certains grades), d’extraction (très ancienne), couronnée (prince de sang), titrée (duc, marquis, comte). La loi de l’an XI sera utilisée à partir du XIX° siècle dans le but d’« aristocratiser » un nom. Le requérant peut invoquer une parentèle noble ou le souhait de relever un nom éteint ; il s’agit parfois de faire légaliser une usurpation pure et simple.
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
19 réactions à cet article
Ajouter une réaction
Pour réagir, identifiez-vous avec votre login / mot de passe, en haut à droite de cette page
Si vous n'avez pas de login / mot de passe, vous devez vous inscrire ici.
FAIRE UN DON