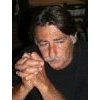Est-ce la nostalgie ? L’éloignement des affaires de l’Etat, peut-être jamais digéré ? Est-ce au contraire une vision vidée de tous les artifices diplomatiques, brute de forge et qui s’épanouit loin des instances dirigeantes ? Toujours est-il que l’ex chancelier allemand Helmut Schmidt, tient un langage radicalisé et extrêmement critique sur le monde politique européen, à commencer par ses successeurs et les dirigeants européens. Comment s’appelle-t-il déjà ? dit-il de Van Rompuy, sensé diriger la chose européenne. Quant à la « ministre » des affaires extérieures de ce dernier, Schmidt est encore moins tendre : « une anglaise dont on peut aisément se passer de connaître son nom ».
L’entretient, accordé à l’OMFIF (Official Monetary and Financial Institutions Forum) basé à Londres et intégralement repris par le Monde concerne essentiellement la crise économique et l’Europe. Une Europe qui régresse, aussi bien au niveau de ses institutions, « ni à Bâle, ni à Bruxelles, ni dans aucun service statistique n’a rien compris, rien vu venir ? » qu’au niveau du processus de sa construction : en ce qui concerne la Grande Bretagne, « De Gaulle avait raison, bien avant l’euro et l’union monétaire,… les anglais sont très forts pour brouiller les choses à leur avantage, et c’est ce qu’ils font maintenant ».
Concernant ce processus régressif il souligne l’aspect « réactionnaire » de l’Angleterre, dont il voit comme raison principale la « dépendance beaucoup trop grande à l’égard de l’Amérique », une dépendance qui augmente systématiquement depuis Wilson, Thatcher et Blair. « Le dernier premier Britannique vraiment europhile, c’est Edward Heath, qui a fait entrer la Grande Bretagne dans la communauté européenne ».
Réactionnaire est un terme qui revient à plusieurs reprises durant l’entretient, pour fustiger la politique européenne de son propre pays et surtout l’idéologie de ses successeurs. « On ne peut pas dire qu’ils ont une pensée libérale. Ils ont une tendance à agir en fonction des seuls intérêts nationaux, et n’ont rien compris à la stratégie de l’intégration européenne. » Mais ils sont aussi réactionnaires, voir incompétents en ce qui concerne la gestion économique de l’Allemagne : « Wolfgang Schäuble, en ce qui concerne les marchés, le système bancaire et la surveillance des banques, tout cela est nouveau pour lui. Il en va de même pour Mme Merkel ».
Derrière l’incompétence, Helmut Schmidt perçoit cependant une carence de perception : « Pendant une longue période, l’élite politique allemande n’a pas compris que nous enregistrions des excédents dans nos comptes courants… Si nous avions notre propre monnaie, elle aurait été réévaluée à l’heure qu’il est... Garder le Deutschematk aurait provoqué une spéculation pire que celle visant la Grèce ou le Portugal ». Globalement, la pensée économique de Schmidt va à contre-courant : à force d’être excédentaire on rase gratis : « Peut-être n’est-ce pas très souhaitable d’être un créancier, car cela vous rend impopulaire. Peut-être que cela signifie aussi que votre solde en banque, vos réserves seront toujours moins élevés que vous l’aviez cru, du fait que les gens ne vont pas être capables de rembourser leurs dettes … Il est un fait que les Allemands se comportent parfois comme s’ils étaient les plus forts, ils ont tendance à donner des leçons à tout le monde. En réalité, ils sont plus vulnérables qu’ils ne croient ». Cette situation de dépendance, entremêlée à une vision bien plus politique, voir psychologique, qui insiste sur le fait que l’Allemagne « aura une dette à payer encore très longtemps » du fait de la guerre, « durant tout le XXIe siècle et peut-être même le XXIIe » devrait inciter les dirigeants allemands à plus d’humilité, s’explique Helmut Schmidt, « or », dit-il, « j’ai l’impression que Merkel n’en a pas conscience ».
De manière plus globale, l’ex chancelier, sans chipotage, donne un tableau sombre de la situation, pointant un système financier ayant une mentalité criminelle, et, en face, une classe politique « qui apprend son métier sur le tas », et « une Europe en manque de dirigeants aussi bien à a tête des Etats qu’au niveau des institutions européennes ».
L’entretient qui oppose politique et technostructures, vision politique et gestion au quotidien, économie politique et opportunisme financier, est en soit (et parfois, l’air de rien, au second degré) une bonne représentation de la dégradation du pouvoir et du personnel politique. Il tombe à pic, pour mettre à nu sa gestion, un fait politiquement insignifiant, l’incident météorologique en Ile de France. A la question faite à Alain Madelin, alors maire de Redon, sur les causes de l’inondation dans sa ville, il répondit : « si je crois bien, la pluie ». Simple peut-être, et sans doute pointée d’humour, la réponse allait à l’encontre de la vision prométhéenne et infantilisante qui cherche toujours un responsable, voir un coupable, à tout, en enlevant au citoyen les moyens d’y faire face.
Aujourd’hui, comme un écolier pris sur le fait de pisser en dehors de la toilette, le premier ministre, par ailleurs connu pour son « sérieux et son flegme », nous dit, « c’est pas ma faute, c’est la faute de la météo ». Son ministre de l’intérieur, constate « qu’il n’y a pas de pagaille, que c’est la presse qui exagère tout ». Quant à la presse, elle en fait ses choux gras, oubliant qu’au même moment, la conférence mondiale sur le climat se dirige vers le flop absolu.
Comprendre le monde, s’abstenir de miser sur l’insignifiant, prévoir l’avenir, comprendre le poids du passé, refuser de commenter tout et n’importe quoi comme étant un problème de vie ou de mort, résister au sentiment de panique ambiant, bref gouverner, semble une espèce en voie d’extinction depuis la fin du XXe siècle.
Comment s’appellent-ils déjà ?